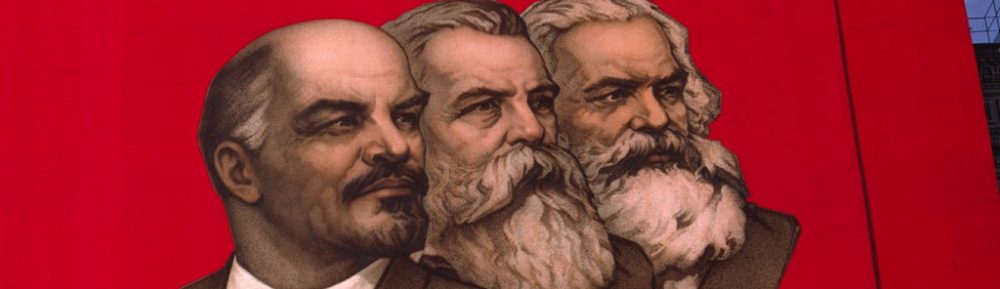La Corse du XXè siècle est peu peuplée. L’exil, la pauvreté, les rivalités de clans et l’ingéniosité du pouvoir n’y sont pas pour rien. Au point que, si on excepte les touristes, les retraités, les mafiosi, les fonctionnaires venus du continent et les politiciens véreux, il ne reste quasiment que les bergers.
La tradition pastorale vient du fond des âges et survit tant bien que mal au modernisme, à la spéculation et à l’éclatement des structures sociales d’antan.
Le Corse aurait pu être pêcheur, agriculteur, artisan ou industriel. Il est berger – ou regrette de ne l’être pas. C’est que l’histoire l’a façonné ainsi.
Au fil des siècles, il a appris, souvent à ses dépens, qu’il ne fallait attendre du littoral que la malaria ou les invasions, du travail que la disette, de l’ambition que les représailles. Il a découvert que les régions les plus accueillantes de l’île n’étaient pas forcément les plus sûres et que les techniques venues d’ailleurs rapportaient surtout à ceux qui en vantaient les mérites. Bref, il a préféré la tradition au changement, la montagne à la plaine, le mouton à la vache, la solitude à la ville, la ruse à la confiance, la vie pastorale à l’entreprise agricole.
C’est au nord-ouest de Corte, dans les montagnes du Niolo, que le berger a le plus longtemps conservé – et conserve encore – l’aspect et les rythmes les plus anciens. Il y a peu, il se vêtait encore du «pelone», tissu de poil de chèvre ou de laine de mouton tissé par sa femme, se protégeant les jambes de peaux de chèvres. Aux foires émaillant l’année, il se rendait dans un habit plus riche, pantalon et veste de velours marron, chapeau noir et chaîne de montre au gousset. S’il apparaît parfois, désormais, dans une tenue plus habituelle, pantalon de jean et veste des surplus militaires, il n’en garde pas moins au fond de lui-même la volonté, la violence, la paix et la méfiance que lui ont enseignées ses ancêtres.
Il n’est pas éloigné, le temps où le berger suivait son troupeau sur les pentes montagneuses, les ramenant parfois près de la maisonnette de pierres sèches où l’attendait un lit de fougères, lorsque le goût folâtre des brebis ne l’emmenait pas à leur suite dans des recoins de maquis où, la nuit venant, son repos ne pouvait se gagner qu’à la belle étoile.
Aujourd’hui, la SOMIVAC (Société de Mise en Valeur de la Corse) offre aux bergers subsides et prêts pour qu’ils défrichent le maquis et enclosent les champs arrachés à la nature sauvage. Le berger fait mine d’acquiescer, il empoche la manne, laisse passer deux ans… et retourne à ses moutons, ses chèvres, ses chiens et sa vie de transhumance. L’automobile abrège parfois les chemins de montagne, le téléphone mord sur les solitudes mais la vie du vieil homme se compte en siècles et en lunaisons. S’il ne reste un jour qu’un Corse en Corse, ce sera un berger.
La bergerie est adossée au rocher, à quelques centaines de mètres du dernier village, près du sentier caillouteux, accessible aux seules mules, qui mène au col, par-delà lequel s’échancre une nouvelle vallée au flanc de laquelle s’accroche une autre bergerie.
Bâtisse de pierres sèches empilées jusqu’à hauteur d’homme, toit de poutres tordues, de tôle ondulée et de branchages, avancée ombreuse sous un châtaignier complice, c’est là que chèvres et brebis reviennent en fin de journée, après avoir volé au maquis escarpé, des kilomètres à la ronde, la pitance quotidienne. Le berger est seul, il appelle les bêtes. Elles se font à peine prier pour entrer dans l’enclos en entonnoir où l’homme les cerne, les pousse et les rassemble, empoignant une à une, par les pattes arrière, ses quatre ou cinq douzaines de brebis aux mamelles plus ou moins gonflées, les retenant l’une après l’autre, prisonnières de ses jambes tandis que, leste, une main a installé sous les pis l’écuelle d’aluminium, alors que l’autre main, furtive et experte, fait déjà gicler à la pointe des mamelles ce lait un rien acide qui servira à la fabrication du fromage.
Rapports d’amour, sensuels, presque charnels, entre l’homme et l’animal. Même si cette rencontre biquotidienne ne dure que quelques instants, même si elle est répétée avec chacune des brebis, inlassablement, même si, avec la mi-été, le lait tarit jusqu’aux premiers jours de l’année, même si le berger ne donne que rarement un nom à ses bêtes, il les connaît toutes et, à une petite différence d’ondoiement dans l’immense masse de laine que représente son troupeau, il discerne les manquantes, repère les malades, surveille les nerveuses. Un bêlement met ses sens en éveil, il vit avec et de son troupeau comme d’autres en famille:
«Je n’ai jamais eu une idée exacte du chiffre de mon troupeau. Je ne connais pas la part des brebis par rapport à celle des chèvres. Je n’ai jamais pu compter les cabris et les agneaux du récent agnelage. Mais je sais, là, maintenant, dans ce petit matin frisquet et dans ce parc de misère, qu’une brebis manque à l’appel. Je la connais tout entière. Par le toucher de sa laine. Par le frémissement plus immédiat de sa peau lorsque je lui tâte la mamelle. Par la couleur très noire de sa pupille. Par sa façon de baisser l’échine lorsque mon genou devient plus proche… (Pepino Nizzi, berger corse).
Y eut-il jamais de plus tendre déclaration d’amour?
Le berger corse est d’abord un fromager. Après la traite, il fait cailler le lait, à froid, avec de la présure obtenue à partir d’estomacs de cabris. Il casse ensuite le caillé, afin que tout le petit lait s’en échappe. Le caillé est versé dans des moules de jonc tressé (désormais, il s’agit souvent de moules de matière plastique) posés sur une planche inclinée et rainurée permettant l’écoulement du petit lait restant. Les fromages sont ensuite salés à deux ou trois reprises, puis affinés dans une cave fraîche. Ils seront vendus plus ou moins secs, selon le goût de l’acheteur… et la demande du marché.
Mais la spécialité du berger, plus encore que le fromage, c’est le «brocciu», fabriqué à base de petit lait provenant du fromage, petit lait auquel on ajoute, dans la proportion d’un cinquième, du lait frais. Ce mélange, chauffé sur un feu sage et continu, doit atteindre 75 degrés. Il se forme alors, à la surface du chaudron, un précipité blanc, qui est lui aussi disposé dans des moules à fromage. Mais sa consommation doit être plus rapide et, généralement, le «brocciu» n’est pas destiné à la vente. Seuls le berger et ses proches le consomment, soit froid, comme un fromage blanc assaisonné, soit dans une préparation d’une extrême onctuosité et d’une fine saveur, l’omelette au «brocciu» et à la menthe…
A la fabrication locale de fromage, vendu aux clients par le berger lui-même, ou par un épicier du village effectuant de petites tournées dans les villages proches, il convient d’ajouter un important débouché pour le lait de brebis corse: Depuis le début du siècle, la Société Roquefort, qui produit dans les caves de Roquefort (France continentale) l’un des meilleurs fromages français, achète une bonne partie de la production corse. Cependant, depuis quelques années, ces rapports commerciaux, qui représentent pour le berger un écoulement sûr mais peu payé, ont été violemment critiqués par les «nationalistes» corses. Quelques attentats ont été perpétrés contre les locaux de la Société Roquefort, des inscriptions vengeresses ont couvert les murs et, de part et d’autre, la nécessité de ces rapports s’est estompée. Ainsi, de nombreux bergers sont revenus à une vente purement locale, largement dépendante du tourisme estival (l’île est très peu peuplée en hiver). Sur ces nouveaux marchés, les prix du fromage dépendent d’abord de l’offre et de la demande, c’est-à-dire du nombre des touristes. Le prix du fromage est donc très fluctuant, les méventes sont fréquentes et, surtout, la qualité va baissant, le touriste se satisfaisant – comme chacun sait – de l’appellation au détriment de la saveur.
La transhumance d’été n’a pas disparu de Corse. Mais, la multiplication des routes et l’essor de l’automobile aidant, le berger revient souvent dormir dans sa maison de moyenne altitude, tandis que le troupeau, amené à la fin du printemps sur les alpages de haute altitude, y restera jusqu’aux premiers jours de l’automne. Jusqu’à fin juillet, le berger rejoint son troupeau chaque matin, pour la première traite, et redescend au village après la traite du soir, emportant dans la voiture le lait que sa femme transformera en fromage et en brocciu. Ensuite, dès la fin juillet, lorsque le lait commence à tarir, il arrive que le berger ne rejoigne son troupeau qu’une ou deux fois la semaine, le temps d’inspecter les malades et de détecter les disparus. Car le berger, au fil des ans, s’est astreint à de nouvelles tâches, le produit du seul pastoralisme ne suffisant plus à l’économie familiale. Nombreux sont les bergers devenus un rien cultivateurs, grignotant au maquis quelques hectares de céréales, récoltant la pomme de terre sur des parcelles caillouteuses, cueillant l’olive ou la châtaigne, ensemençant un riche potager proche de la maison de famille, alimentant quelques porcs avec le surplus de lait dans un enclos où piaille une impressionnante basse-cour. Ainsi, le berger parvient à ne devoir acheter au village que quelques produits de première nécessité (sel, tabac, café, essence) et à vivre en quasi-autarcie grâce à sa production. Ce qui n’empêche pas l’île de se dépeupler un peu plus chaque année, et le maquis d’envahir inexorablement les terres abandonnées de bergers lassés, d’héritiers en chamaille ou de jeunes adultes ayant préféré le confort d’une vie de fonctionnaire à la vie difficile de leurs parents.