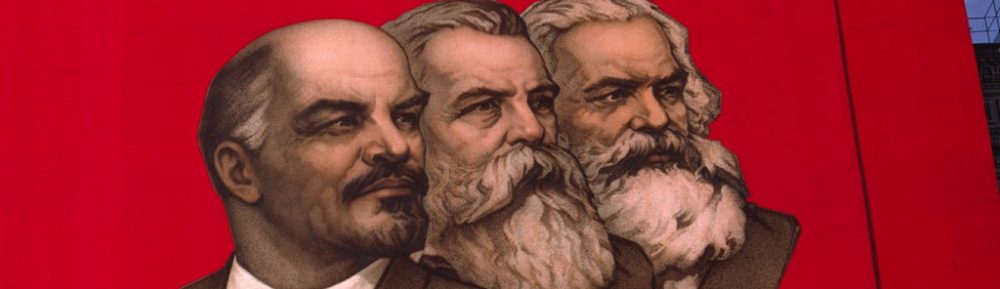En novembre 1977, Jean-Christophe et Martina imaginent une étrange machine à remonter le temps : ils partent pour passer dix jours, avec les jumelles, à Bad Ragaz. S’ils le pouvaient, ils retourneraient dans la chambre de la Sonnengasse. Mais elle est occupée et ils se rabattent sur une adresse que leur fournit l’Office du Tourisme.
Méthode Coué ? Réflexe de Pavlov ? Autosuggestion ? Nostalgie ? Cigarette du condamné ? Pourquoi sont-ils revenus ici, dans les lieux qui ont abrité la rencontre de leurs corps et l’ébauche de leurs projets ? Ni l’un ni l’autre, aujourd’hui, ne saurait répondre à cette question.
Ce qui est sûr, c’est qu’ils y retrouvent le bonheur paisible de parents comblés, la fougue attentive d’amants aux aguets, la sérénité confiante d’adultes au chemin bien tracé. Le mot avenir n’est plus prohibé. On dit : « Je t’aime » la nuque tendue, les pupilles dilatées.
J’ai sous les yeux une photo de cette décade. Les bas-côtés d’une route de campagne sont déjà tachetés de neige, la lumière et les herbes sèches ont des reflets jaunasses, l’air doit être vif. Les roulettes du landau double évoquent le train d’atterrissage d’un Boeing. Une longue silhouette moustachue, harnachée d’un vêtement de laine blanche qui pourrait être une gandourah (il s’agit, en fait, du cadeau d’une cantine populaire chilienne), est aux commandes. A sa droite, de deux têtes plus petite, une femme aux cheveux noirs, mi-longs, dans un manteau marron tricoté. Sur le visage de l’homme, la fierté douce. Sur celui de la femme, l’épanouissement harmonieux. C’est la dernière fois que Jean-Christophe et Martina donnent ainsi à l’objectif, ensemble, l’image du bonheur. Si Martina le pressent, Jean-Christophe pourrait, lui, jurer du contraire.
La douche froide l’attend à Genève. Quelques jours seulement après leur retour, Jean-Christophe apprend que Martina a pris rendez-vous avec un avocat – qui plus est, il s’agit d’Adrien Schneider, ami et compagnon politique de Jean-Christophe – pour entreprendre les démarches en vue du divorce.
– Mais enfin, Martina, pourquoi ? Parle ! On était bien, à Bad-Ragaz, non ? Bien sûr, tout le monde peut en avoir assez, à un moment précis. Nous sommes trop ensemble. Il faut peut-être que chacun vive quelque temps de son côté. Mais il ne faut rien faire de définitif, Martina. Pense aux enfants. Ce ne sont pas que tes enfants, ce sont aussi les miens. Et, surtout, ils ont le droit d’avoir une mère et un père. Et un père, Martina.
Des jours de monologue. Questions inquiètes d’un côté, silence de l’autre. La vie, à Vernier, devient mesquine. Pas un sourire, pas un geste de tendresse. Jean-Christophe a du mal à obtenir de poursuivre son rôle quasi-maternel à l’égard des jumelles.
– Laisse, je m’en occupe ! Ce sont à peu près les seuls mots de Martina.
Autre mauvaise surprise, le revirement de Vera. C’est une voisine, amie jusque-là de Jean-Christophe comme de Martina. Elle est divorcée d’avec un Algérien. Une fille est née de cette union. Le tribunal a attribué la garde à la mère. Mais le père s’est enfui avec la fille en Algérie où, sombrant dans l’alcoolisme, il l’a confié à une de ses soeurs.
Vera n’a pu lui rendre visite, en sept ans, qu’à trois reprises. Elle a songé à l’enlever. Sitôt quitté le territoire algérien, elle aurait pu faire valoir son bon droit. Mais la famille du père, craignant sans doute une telle manœuvre, avait pris des dispositions. Si bien que Vera, avant de rencontrer sa fille, était tenue, à chaque visite, de déposer son passeport au commissariat de police. Et chacun sait bien qu’on ne sort pas d’Algérie les mains dans les poches et la fleur aux lèvres…
Crève-cœur pour Vera. Jean-Christophe avait tenté de lui prêter main forte. Un enlèvement avait été étudié. Vera avait sollicité l’aide de Denis Payot, l’avocat. Payot avait même proposé d’effectuer lui-même l’enlèvement, dans l’espoir que ses excellents contacts avec Boumedienne lui assureraient la sécurité. Un ou deux voyages à Alger l’avaient cependant convaincu du contraire et il avait fait savoir à Vera qu’il renonçait.
Et c’est cette femme qui, oubliant délibérément l’amitié et le soutien passés de Jean-Christophe, se ralliait à la cause de Martina. Sans doute y voyait-elle une réconfortante analogie. Il y avait là de quoi inquiéter.
«Etranger. Frontières. Enlèvement. Enfant. Avec la mère.» Jean-Christophe résume ses craintes pour l’avocat qu’il vient de choisir, Jean-Pierre C., un autre ami de longue date, comme lui engagé à gauche. Puis c’est le militant qui renaît en lui. Son propre cas, il va en faire le prétexte d’un combat. Il prendra contact avec l’ASPER (association des pères) puis avec le MCP (mouvement de la condition paternelle). Ainsi se noueront des liens avec des pères qui se battent, soit pour récupérer des enfants dont la garde a été à leurs yeux arbitrairement attribuée à la mère, soit pour obtenir que les jours de visite soient respectés, soit enfin pour qu’un nouveau jugement leur accorde, sinon la garde complète, du moins la garde conjointe ou la garde alternée.
En Suisse, plus encore que dans d’autres pays européens, ces deux notions sont pratiquement inconnues. On en est encore à l’idée, simple, sereine, rassurante et manichéenne selon laquelle l’enfant est mieux avec sa mère. Les juges n’en attribuent la garde au père que si la mère est ivrogne, droguée, voleuse ou prostituée. Et encore. Kramer contre Kramer, connais pas !
Le prototype le plus criant de cette arrière-garde se nomme Jean-Nicolas R. Il est alors sous-directeur (et bientôt directeur) du Service de Protection de la Jeunesse, à Genève. Avocat (un médecin ou un psychologue ne conviendrait-il pas mieux au rôle ?), il est pour les solutions claires et tranchées. Le mieux, en cas de séparation et de divorce, est « l’amputation d’un des parents », généralement le père. Il sépare les fruits du couple comme on partage les actifs d’une société en faillite. Et tant pis si, quelques années plus tard, le gosse demande à sa mère
– Dis, maman, tu l’as connu, papa ?
Parce qu’il aime Martina, et parce qu’il ne veut pas devenir, d’un trait de plume, un fantôme, Jean-Christophe décide de s’opposer au divorce. Par tous les moyens légaux.
En septembre, une première ordonnance du juge lui donne raison : maintien de toute la famille au domicile conjugal, à Vernier. C’est Jean-Christophe qui, son avocat ayant fait meilleur diligence pour le prévenir de la décision, l’apprend à Martina.
Assise dans la cuisine, en face de Jean-Christophe, elle porte Melia dans ses bras puis se lève l’un bond, arrache Corina des genoux de Jean-Christophe, grimpe quatre à quatre les escaliers de bois et s’enferme dans sa chambre. Une heure plus tard, elle n’entrouvre que pour crier :
– Je n’ai pas l’intention de rester plus longtemps dans cette maison.
– Calme-toi. Et dis-toi que nous avons de la chance : les juges n’ont pas encore tout foutu en l’air.
– Je ferai recours.
Les rapports sont glacés, limités à l’extrême. Mais Jean-Christophe reprend espoir. Si Martina fait recours, cela va prendre du temps. Elle pourra s’amadouer, changer d’avis, redevenir sa femme.
Le 18 octobre, Jean-Christophe se lève vers six heures. Martina dort encore. Il se fait chauffer un café de la veille, se prépare. A sept heures, il réveille les jumelles (l’alternance des tâches est respectée, comme aux premiers jours), les habille, confectionne leur biberon. Entretemps, Martina est descendue à la cuisine. Jean-Christophe embrasse longuement Corina et Melia, esquisse le signe d’un baiser à l’intention de sa femme.
– Je serai de retour avant midi.
– D’accord.
Le jour est à peine levé. Il enseigne à huit heures moins cinq. S’il ne se hâte pas, il sera en retard. Il ne prend même pas le temps de relever le col de sa veste de laine. Pourtant, les matins commencent à fraîchir sérieusement.
Midi. Il a laissé la Lada sur le parking, de l’autre côté de la route. Un premier détail le surprend, il n’y a pas de rideaux aux fenêtres. Il pousse la porte et découvre un invraisemblable désordre. La plupart des meubles ont disparu, des papiers jonchent le sol, plusieurs planches de la bibliothèque ont été dressées contre le mur. La panique le saisit. Vol organisé ? Descente de police ? Attentat ? Ou fuite ?
Il grimpe en hâte les escaliers pour découvrir, au premier, un spectacle identique. Redescend. Sur l’unique table restée à sa place, dans la pièce arrière, un billet.
« Jean-Christophe, le jugement rendu ne résolvant pas le problème et vu l’atmosphère insupportable, tu m’obliges à déménager avec les enfants. Mon adresse est 6 route de Bernex à Lully, où tu pourras venir voir les enfants en ma présence. Tu peux déjà venir ce jeudi, de 12 h 30 à 14 h 30, puis nous établirons un horaire le plus large possible. Martina. »
De toute évidence, Martina a été aidée et conseillée. Aidée parce qu’on ne déménage pas, seul, en une matinée, la moitié d’un mobilier de cinq pièces. Conseillée parce que le billet n’est pas dans son style. D’écriture peut-être. Pas de comportement. Au pis-aller, elle aurait pu demander les services d’une entreprise de déménagement pour ce qui est des meubles. Mais, pour la lettre, elle a pris les conseils d’un homme de loi. Schneider ? C’est bien possible.
Ainsi, désemparé, hagard, Jean-Christophe ne peut pas prétendre qu’il y a eu enlèvement, ni que ses enfants sont en danger. Il sait où ils se trouvent. Il est même invité à venir vérifier qu’ils ne sont pas confinés dans un taudis.
Il ne tombera pas dans le piège. Se rendre à Lully, ce serait reconnaître le fait accompli. Ce soir, il sera seul dans la maison vide et froide. Mais, dès aujourd’hui, il fait appel à la Justice. Un juge a maintenu femme et enfant au domicile conjugal. Ce n’est pas un coup de force qui doit primer sur le droit.
Cependant, toujours efficacement conseillée, c’est Martina qui, au vu des faits nouveaux qu’elle a pourtant elle-même créés, s’adresse au juge pour demander de « nouvelles mesures provisoires ». Elle a quelques heures, peut-être quelques jours d’avance sur Jean-Christophe qui doit encore, lui, consulter son avocat avant de choisir la procédure. Quelques heures – ou jours – qui vont faire toute la différence.
Une semaine a passé. Jean-Christophe n’a pas pu, du jour au lendemain, demander l’annulation des cours qu’il doit donner. Il enseigne donc et c’est tant mieux. Ses élèves remarquent à peine son air las, ses tics nerveux, les courts instants où sa conscience s’égare. Mais, le soir, dans la maisonnette nue, lugubre, provocante de souvenirs trop frais, il pleure. Il voudrait voir les enfants, les bercer, les baigner, leur donner le biberon. Il est seul.
Dans la boîte, une convocation du juge pour une comparution personnelle, le 30 octobre. A la requête de Martina, qui demande que lui soit attribuée la garde.
– Bon, Monsieur Sümi. Les enfants sont bien avec la mère. D’accord, il y a eu coup de force. Mais vous vous en doutiez un peu, non ?
La décision est notifiée une semaine plus tard : « Dès lors, le Tribunal devant faire un choix, et en étant certain que, quelle que soit la décision, les enfants seront bien encadrés et soignés, choisira de les confier à la mère selon une politique traditionnelle confirmée par la doctrine de la jurisprudence ».
La mesure est assortie d’une pension (deux cent cinquante francs par mois et par enfant) et d’un droit de visite, un week-end sur deux et un jeudi sur deux.
Jean-Christophe dépose un premier recours.
Le résultat de cette démarche ne tombera que cinq mois plus tard, en avril 1979, et confirmera l’attribution de la garde à la mère, de même que les droits et jours de visite du père. Seul changement, la pension sera augmentée de cent francs par enfant.
Jean-Christophe ne s’avoue pas battu. D’abord, il s’efforce d’utiliser au maximum les visites que lui accorde le jugement. Pour les week-ends et les jeudis auxquels il a droit, par exemple. Il considère, sur ce point, que la durée d’une journée est effectivement de vingt-quatre heures. Ainsi, le jeudi, il exige d’avoir les enfants, soit du jeudi matin au vendredi matin, même heure, soit du mercredi soir au jeudi soir. Même chose pour le samedi et le dimanche. Il veut que les enfants, outre les journées entières passées avec lui, restent aussi la nuit. Parce qu’il a la nostalgie du temps, pas si éloigné, où il langeait, maternait et s’éveillait en pleine nuit au son d’un pleur, d’un rire, d’un mouvement. Et aussi parce que, si les jumelles doivent sentir l’égalité entre la mère et le père, les nuits y sont aussi utiles que les jours.
Tout cela ne se fait pas sans mal. Martina tente de s’opposer à cette interprétation du jugement. Les lettres de son avocat se multiplient. Jean-Christophe continue.
Les rencontres sont particulièrement difficiles. A Lully, le dialogue est réduit au strict minimum. Martina ne s’exprime en français qu’à l’intention de Jean-Christophe, quelques mots, l’indication de l’heure de retour, rien d’autre. Avec les jumelles, même en présence de leur père, elle ne parle que catalan. Jean-Christophe en ressent une inquiétante frustration, doublée d’une pernicieuse atteinte à sa dignité. Surtout, il sent bien que cette méthode, systématique entre mère et enfants lorsqu’il n’est pas présent, aura tôt ou tard pour effet de l’éloigner plus encore de Corina et Melia. Aussi, à peine les a-t-il avec lui qu’il leur raconte d’étonnantes histoires dont elles ne saisissent que la musique
Corina et Melia ont à peine deux ans. Les mois passent.
En décembre 1979, la Chambre des Tutelles de Genève, après avoir convoqué Martina et Jean-Christophe, leur fait signer une convention de garde alternée. Jean-Christophe obtient la garde des jumelles cinq jours sur quatorze. Ce n’est pas encore l’égalité, ni l’équité, mais il en tire une solide bouffée d’espoir.
La Chambre des Tutelles établit un premier agenda, répartissant les périodes de garde des enfants. Trois jours la première semaine, deux la seconde, et ainsi de suite. Martina s’est opposée à des périodes complètes de cinq jours.
Jean-Christophe revit. Dans la pièce du haut, à Vernier, les jeux cohabitent allègrement avec les livres et dossiers. Jean-Christophe a construit une immense cabane – carton de machine à laver troué de fenêtres aux volets verts et d’une porte par laquelle les jumelles se glissent en catimini. Aux biberons succèdent les bouillies, puis les premiers repas semblables aux siens. L’immense gaillard filiforme et moustachu est plus souvent allongé sur le parquet, jouant avec ses filles, qu’assis à son bureau pour la rédaction de rapports ou de cours. Depuis près de deux ans, il a abandonné son mandat à la Fédération Internationale des Droits de l’Homme. Il pensait ainsi pouvoir disposer de plus de temps pour l’éducation de ses filles. Son espoir renaît peu à peu, après des mois de solitude et d’angoisse.
– C’est vrai, papa, tu veux nous tuer ?
– Comment, Melia ?
– C’est vrai que tu veux nous tuer ?
Il s’effondre sur le petit canapé de son bureau. Les tuer. Qui donc a-t-il pu leur souffler cette énormité. Bien sûr, des gamines de deux ans, si elles peuvent répéter des mots, n’ont de la mort aucune idée. Ce qu’on leur a dit ne les effraie pas. Mais pourquoi ? Et qui ? Ce n’est pas par jeu qu’on a dit ça aux gosses. La démarche est préméditée. Pour qu’elles le répètent alentour, à une assistante sociale ou un juge. Et peut-être aussi pour que cette phrase renaisse un jour en elles, bien plus tard, lorsqu’elles seront en mesure de la comprendre complètement.
Au début du mois de mars, Martina et Jean-Christophe se retrouvent chez le juge des Tutelles. Il s’agit, non de modifier l’acquit de la garde alternée, mais simplement d’établir le programme de répartition jusqu’au début de l’été. Jean-Christophe est chargé de faire des propositions précises et de les faire parvenir au juge dans le délai d’un mois.
Le 26 mars 1980, pour la première partie des vacances de Pâques, il va chercher les jumelles à Lully. Elles doivent rester avec lui un peu plus d’une semaine après quoi, le 3 avril, il les ramènera chez Martina, qui partira le lendemain pour la maison que possèdent ses parents, à proximité de Barcelone.
Trop longue et trop courte, cette semaine. Trop courte parce que Jean-Christophe ne se lasse pas de vivre avec ses filles. Il n’enseigne pas et ses journées entières leur sont consacrées. C’est la saison où réapparaissent les premiers rayons de soleil. Les jeux débordent sur la cour. Le gros chien aux poils emmêlés qui, en leur absence, peuple la maison vide de sa bonhomie, est un complice de choix. Le soir, ou à l’heure du repas de midi, Jean-Christophe profite du calme relatif pour parler. Et écouter. Il sent qu’avec de la volonté, de l’assiduité, il va pouvoir faire de Corina et Melia ses amies. Et ça, aucun juge ne pourra y mettre fin.
Trop longue parce qu’il connaît la destination de Martina. Chaque jour, il se demande que faire. La laisser partir, c’est prendre un risque énorme. Reviendra-t-elle ? Elle en a, certes, fait la promesse au juge. Mais que vaut un serment lorsqu’on peut, pour toujours, échapper à une vie, une ville, un passé qu’on répudie ? L’en empêcher, impossible. Ne pas lui rendre les enfants, ce serait lui donner des armes pour que le juge ne reconduise pas la garde alternée.
Le 3 avril 1980, au soir, il sonne à la porte de l’appartement de Lully. Les jumelles sont avec lui, il les tient par la main. La porte s’ouvre. Martina est là, ni plus dure, ni plus douce qu’à l’accoutumée.
– Bon voyage
– Merci.
– Tu seras là le 10 au soir…
– Comme prévu.