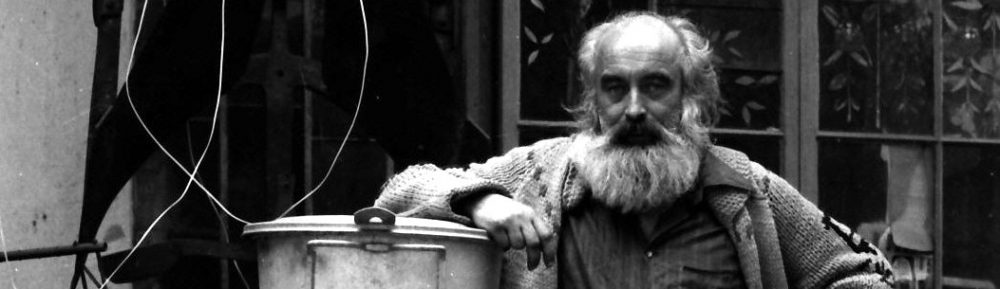– Buna ziua. Alex sint. Rodica este, va rog ?
– Rodica nu este acasa, este la scoala…
En ce printemps de 1971, lorsqu’à Bucarest j’appelais Rodica chez ses parents, la réponse de sa maman était presque toujours la même. Rodica était à l’école mais elle allait bientôt rentrer. Il me fallait rappeler plus tard.
Rodica, je l’avais rencontrée quelques semaines auparavant, au monastère de Ţiganesti. C’était l’hiver roumain, clair et glacé. L’écharpe lui montait jusqu’au-dessus du nez et le bonnet de laine recouvrait jusqu’aux sourcils. Je n’avais donc aperçu d’elle que deux yeux d’émail sombre, fiers sans arrogance, curieux sans insistance. Elle accompagnait son père, haut fonctionnaire au Ministère des Cultes. Je ne sais plus qui de nous trois fit le premier geste, prononça la première parole. Je n’aurais pas pu quitter l’église sans savoir quelle âme cachait ce regard.
Et pourtant, j’avais appris à me méfier. Je venais d’être reçu par Nicolae Ceausescu et la photographie de cet entretien avait fait la une de Scanteia, l’omniprésent journal du Parti. J’aurais dû me sentir tranquille, protégé, mais j’étais aux aguets et je savais bien pourquoi. Une semaine plus tôt, à l’aéroport de Zurich, le « diplomate » roumain m’avait accompagné jusqu’à la salle d’embarquement du vol Tarom et là, il m’avait demandé de lui rendre amicalement un petit service. A la fin du mois, sa nièce fêtait son anniversaire et il lui avait acheté en Suisse un cadeau introuvable à Bucarest, une montre en or qu’il me priait de lui remettre en mains propres dans la capitale roumaine.
Je survolais maintenant la Hongrie et le cadeau me brûlait les doigts. L’importation de métaux précieux était interdite en Roumanie, je le savais et même mon rendez-vous avec le « conducator » Ceausescu ne m’autorisait pas à enfreindre la loi. D’ailleurs, le petit écrin enrubanné ne contenait-il qu’une montre ? A l’époque, la méthode des agents de renseignement des pays de l’Est consistait à flatter et compromettre leurs « amis » de l’Ouest pour mieux les recruter. J’étais un « ami » de la Roumanie. Je savais donc ce qui m’attendait…
A l’aéroport de Bucarest Otopeni, je savais être attendu par Ion P., dont j’apprendrais bien plus tard qu’il était un des plus importants agents de la Securitate. Mais il me fallait d’abord subir les contrôles de douane et de police. Qu’allais-je faire de mon encombrant cadeau, comment allais-je en expliquer la présence dans ma poche. Plutôt que de suivre la petite cohorte des voyageurs, je me faufilai jusqu’aux toilettes du secteur international, la petite boîte dans la poche de ma veste. Je m’enfermai et j’attendis. De longues, très longues minutes. Maintenant, tous les voyageurs avaient sans doute franchi les contrôles et l’absence d’un passager devait avoir été remarquée. Je rajustai lentement mes vêtements, remis ma veste et regagnai le hall entièrement vide. Inquiet, mon honorable correspondant, usant de son coupe-file officiel, avait pénétré dans le secteur international pour partir à ma recherche. C’est exactement ce que j’attendais de lui. Je déboulai du couloir désert et le saluai, exprimant ma gêne de l’avoir tant fait attendre pour une banale indisposition intestinale. A voix basse, comme pour lui confier un secret, je lui demandai de s’approcher et lui remis discrètement le paquet contenant la montre. Il n’eut pas le réflexe de refuser, l’enfouit dans son grand imperméable et franchit les contrôles par le portillon réservé aux officiels, sans encombre. Dans la longue Mercedes noire du Ministère qui nous emmenait à l’hôtel, je ne la lui réclamai pas et il ne me proposa pas de me la rendre. Jamais la « nièce » ne prit contact avec moi pour récupérer son cadeau. Sans doute n’avait-elle jamais existé.
Pourtant, ce jour-là, mes ennuis n’étaient pas encore terminés. Le portier de l’Athénée Palace nous accueillit avec tout le respect dû à notre rang mais hélas, pour une raison que j’ignorais, ma grosse valise n’avait pas été placée dans le coffre de notre voiture et ne fut apportée dans ma chambre qu’une bonne heure plus tard. La serrure en était toujours fermée et, à l’intérieur, mes différents effets se présentaient comme je les avais moi-même rangés, en Suisse, au petit matin. Cependant, la fermeture de la trousse de toilette n’était pas exactement tirée comme j’avais l’habitude de la faire. Je refermai le couvercle et les serrures, inspectai la valise sous toutes ses faces. Ce modèle d’une grande marque spécialisée dans les bagages à coque plastique comportait, sur l’arrière, une longue charnière courant de manière ininterrompue sur plusieurs dizaines de centimètres. Or la tige, légèrement tordue, dépassait anormalement d’un demi-centimètre. Sans toucher aux serrures, quelqu’un avait donc ouvert ma valise par l’arrière, avait inspecté son contenu jusqu’à la trousse de toilette, puis avait replacé la charnière sans réussir à en faire complètement pénétrer l’axe, persuadé que ce détail n’attirerait pas mon attention. Bienvenue dans la République Socialiste de Roumanie !
Et Rodica dans tout ça ? Alors que nos regards se croisaient longuement, les premières interrogations m’assaillaient. Faisait-elle, sciemment ou à son insu, partie d’un nouveau plan destiné, lui aussi, à me compromettre ? Etait-il possible, dans ce pays où tout contact avec un étranger devait être immédiatement rapporté à la police, qu’elle me rencontre sans en faire rapport, ou sans être inquiétée ? J’allais entamer avec elle un premier dialogue appelé – eh oui – à durer plus de trente-cinq ans. Elle s’était débarrassée du bonnet et de l’écharpe, son beau visage m’était apparu, sa bouche avait prononcé quelques mots. Elle parlait parfaitement français. Anglais aussi d’ailleurs. Et faisait des études de langues.
De deux choses l’une. Ou bien, consciemment ou pas, elle servait d’appât et je devais absolument me garder d’elle. Ou bien le hasard seul avait présidé à notre rencontre et je ne devais en aucun cas lui faire prendre de risques. Après la première rencontre de Tiganesti, nous nous sommes revus à Bucarest, où désormais je reviendrais au moins deux fois l’an. Je l’appelais. Sa maman me répondait que Rodica était à l’école mais qu’elle allait bientôt rentrer, qu’il me fallait rappeler plus tard. Nous nous donnions alors rendez-vous au pied d’un monument, sous le porche d’une église, à l’entrée d’un parc. Puis nous marchions, marchions. Et nous parlions, parlions. D’histoire, d’architecture, de religion, de nature, d’art, de musique. Jamais de politique. Une première fois, puis une autre, elle m’avait autorisé à la raccompagner jusqu’à la petite maison de ses parents, près du quartier juif, pas loin de ce qui est devenu depuis lors le « Palais du Peuple » voulu par Ceausescu. Je venais aussi l’y chercher. J’avais fait la connaissance de sa mère, une belle femme charmante et menue. De son père que ramenait en fin de journée un chauffeur du gouvernement. De sa jeune sœur au rire sonore.
Etions-nous amoureux ? L’était-elle ? A demi-mots, nous avions envisagé de nous installer un jour dans un pays qui ne fût de langue ni française ni roumaine, afin que chacun de nous deux eût à fournir le même effort de dépaysement et d’intégration. Etait venu l’été, j’avais pu louer une voiture et emmener Rodica dans un village des Carpates, là où sa famille avait l’habitude de passer régulièrement quelques jours de vacances. Nous marchions main dans la main, puis nous nous asseyions sur un banc. Elle me tendait dans un cornet de papier journal quelques unes de ces graines de tournesol dont les Roumains ne sauraient se passer et que mes dents décortiquaient maladroitement. Nous rentrions en amoureux dans la maison amie mais nos effusions s’arrêtaient là. Respect de sa frêle jeunesse ou peur de me brûler les ailes ?
Nous étions devenus de tendres amis, de discrets complices. Trois ans avaient passé. J’étais à nouveau à Bucarest, couvrant comme journaliste la Conférence mondiale de la Population que Ceausescu avait voulue pour renforcer son image d’homme de paix et d’ouverture. Je me trouvais avec un confrère belge à la terrasse du charmant café China, à deux pas de l’Athénée. Un vieil homme avait pris le risque de s’approcher de notre table. Il parlait un français du XIXème siècle et s’intéressait à l’histoire, à la numismatique. Il n’avait jamais vu de monnaie suisse. Je lui tendis une minuscule pièce de cinquante centimes qu’il saisit entre pouce et index pour mieux la contempler. De la table voisine, deux hommes se levèrent soudain, l’empoignèrent sous les aisselles, le poussèrent dans une Dacia stationnée au bord de la place et l’emmenèrent vers un vraisemblable interrogatoire musclé. Il venait de se rendre coupable de deux fautes gravissimes, parler à des étrangers et détenir des devises étrangères…
Nous nous sentions moralement responsables de ce qui arrivait à ce vieil homme. Pendant tout l’après-midi, nous fîmes le tour des postes de police, prîmes contact avec nos anges gardiens du Ministère des Affaires étrangères. Nous exigions que l’homme soit relâché, ce qu’on nous promettait, et que nous puissions le vérifier par nous-mêmes, ce qu’on nous refusait.
Je m’endormis la rage au ventre puis, le lendemain matin, en direct, je racontai aux auditeurs suisses cet épisode banal du bonheur socialiste roumain. Ensuite, je pris le premier avion, bien décidé à ne revenir que lorsque j’aurais obtenu des nouvelles du vieil homme. Je n’en obtins pas. Pire, mon honorable correspondant en Suisse, celui qui m’avait confié la montre destinée à sa nièce, me fit fermement savoir que le traître que j’étais devenu ne pouvait prétendre à aucune faveur, aucun visa. Je ne remis donc pas les pieds en Roumanie pendant plus de quinze ans, jusqu’à la Révolution. Je ne revis plus Rodica, ne lui donnai plus signe de vie, attaché à ne pas la mettre en difficulté.
Janvier 1990. La Révolution a éclaté depuis deux semaines. Dans les forêts, des « terroristes » menacent, affirment la télévision, la liberté si chèrement conquise. J’escorte jusqu’en Transylvanie un des innombrables convois humanitaires d’Opération Villages Roumains. Ensuite, je ne repars pas pour l’Ouest. Me voici à Bucarest, reprenant le fil de mes enquêtes interrompues depuis tant d’années. Prétexte. En fait, je cherche Rodica. Le numéro de téléphone d’autrefois sonne dans le vide et le dernier bottin remonte à plus de vingt ans. Impossible de renouer le fil. Alors, je parle autour de moi de cette famille dont le père, je l’ai appris entre-temps pas la presse occidentale, est devenu ministre de Ceausescu avant d’être sèchement écarté du gouvernement, pour « incompatibilité » réciproque. Par hasard, je rencontre une anesthésiste de l’Hôpital des Enfants qui croit savoir comment retrouver le papa et donc, je l’espère, sa fille.
Deux jours plus tard, je tiens en main un petit papier sur lequel a été griffonné le nouveau numéro, que je compose lentement. Une, deux, trois sonneries. Et une voix connue.
– Buna ziua. Alex sint. Rodica este, va rog ?
– Buna ziua Alex. Rodica nu este acasa, este la scoala…
Dix-neuf ans plus tôt, j’avais appelé pour la première fois. Dix-neuf ans plus tôt, la maman m’avait répondu :
– Bonjour Alex. Rodica n’est pas là, elle est à l’école. Elle va bientôt rentrer. Rappelez plus tard.
Dix-neuf ans plus tard, avec les mêmes mots, la même intonation, la même bienveillance, elle me répondait au téléphone comme si nous nous étions parlé la veille, nullement surprise, égale à elle-même. En Roumanie, rien ne change, ou si peu. D’étudiante, Rodica était devenue enseignante. Elle avait quitté la maison familiale pour se marier, y était revenue après son divorce. Tout à l’heure, lorsqu’elle serait rentrée de l’école, je l’appellerais, nous nous donnerions rendez-vous à l’entrée du parc, nous y reprendrions la conversation là où nous l’avions laissée en 1974 et, cette fois, nous ne laisserions plus le temps nous séparer.
Quelques mois plus tard, à Genève, monsieur le maire nous déclarerait mari et femme. Et tant pis si, dix-neuf ans plus tôt, la jeune femme aux yeux sombres n’était pas venue au monastère de Tiganesti tout à fait par hasard.