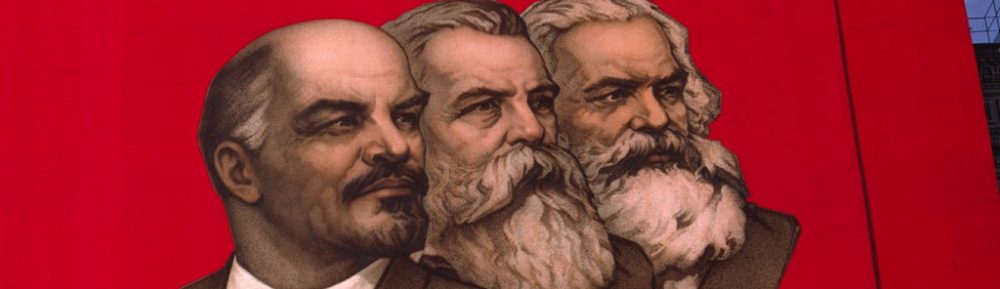Il n’est pas six heures. Le jour se lève à peine sur cette journée du 6 juillet. Pourtant, sur la petite route qui contourne la bourgade de Sedilo (celle des bandits Culeddu Falchi et Peppineddu Pes … ), voitures et camionnettes se faufilent, sous le regard impuissant de deux carabiniers, pour s’engouffrer à qui mieux. mieux sur un chemin de terre, orienté au sud, qui descend vers le lac artificiel. Des grappes plus sages, débarrassées de leurs véhicules, se hâtent à pied vers le même but. La brume légère qui recouvre la plaine rousse donne un aspect de quiétude irréelle aux collines, aux bosquets et au miroitement du plan d’eau.
Deux kilomètres plus loin, le chemin se resserre encore, remonte vers un léger promontoire marqué d’une croix de fer forgé, puis dévale le flanc du coteau pour passer sous la voûte de pierres sèches marquant l’entrée du domaine de San Costantino.
Au-delà de la muraille, on distingue quelques maisons basses accolées et, au centre d’une place ombragée, une autre croix, montée sur un socle évoquant une fontaine de village. Plus loin, à flanc de montagne, à la lisière de la forêt de pins, le clocher court d’une chapelle rustique marque la limite visible.
Partout, ce ne sont que mouvements de foule, gosses s’installant sur quelque pierre levée, femmes de noir vêtues prenant place sur la pelouse en pente, hommes fabriquant des sièges de fortune. Et aussi petits marchands ambulants vantant des aiguilles-miracle et de la poterie domestique, stands de bois proposant du café chaud ou des anguilles grillées, groupes de jeunes gens passant dans la foule pour vendre trompettes de plastique ou cierges de piété.
Les rayons du soleil réchauffent maintenant les plus frileux, mais le fond de l’air est encore frais.
A midi, la chaleur sera torride et les lieux déserts. Pour l’heure, les ultimes retardataires tentent de gravir la colline, quelques coups de feu claquent du côté de la croix de fer, chacun se met en place, laissant ouvert un long passage de quelques mètres de largeur, menant de la croix à la chapelle, en serpentant par le porche de pierre, la croix-fontaine et le muret soutenant l’esplanade accrochée à la colline.
Près de la croix, les meilleurs cavaliers de la région se sont rassemblés. A un signe, leurs montures bondissent, se jettent dans la poussière du chemin, passent en trombe le porche trop étroit, bousculent quelques imprudents piétons, virevoltent au centre de la place, se cabrent un instant lorsque éclatent des salves de mousquets, allongent le col pour s’attaquer à la colline et, les éperons dans la chair, forcent l’allure à mesure que se rapproche la chapelle.
Course traditionnelle, qu’on vient voir de centaines de kilomètres à la ronde, pèlerinage annuel vers cette petite église proche de Sedilo où, dit-on, San Costantino fit des miracles. Les cavaliers tournent maintenant au pas; c’est l’«ardia», la garde. «Sa pandela madzore», le cavalier responsable du groupe, maintient sa monture en tête, passe au pied du mur est où brûlent des dizaines de cierges dont la cire molle menace l’équilibre des chevaux.
Il tient en main un solide gourdin dont il assénera de violents – et véritables – coups à quiconque tentera de le devancer. Puis chacun des cavaliers, mettant pied à terre, confiera pour quelques instants sa monture à quelque connaissance, le temps d’aller se recueillir dans la chapelle où, près des icônes, trônent des centaines de photographies, de dessins naïfs, de lettres encadrées, autant de suppliques émanant de malades et de désespérés, autant d’actes de grâces remerciant San Costantino d’avoir sauvé la vie du frère motocycliste, du père soldat ou de la tante invalide. Dehors, les chevaux piaffent.
Ils sont encore assez frais, la matinée encore assez douce, pour que tous les cavaliers se réunissent une seconde fois sur la colline de la croix avant de S’élancer pour une nouvelle course, une nouvelle «ardia». Ensuite, lentement, chacun regagnera sa voiture, sa camionnette ou son autobus. La journée ne fait que commencer. Et les travaux des champs n’attendent pas…
L’hiver n’est plus qu’un souvenir. Les festivités populaires de Carnaval y ont mis fin. Carnaval, c’est le temps des caprices et du renouveau, bref, le temps des folies. Les hommes possédant un cheval traversent au galop les bourgades, jetant aux gamins des châtaignes, des cacahuètes, des caramels. Sur la place, une estrade a chassé les voitures, un orchestre de quelques musiciens s’est installé et les couples face à face dansent le «ballo sardo», ce bal sarde qui tiendrait de la simple bourrée, n’était la finesse du pas, la complexité des enchaînements, la rigueur des évolutions en groupe. A Oristano, la «Sartiglia» de Carnaval est une course au cours de laquelle des dizaines de cavaliers, armés d’un bâton, galopent en groupe dans la rue, s’efforçant chacun, debout sur les étriers, de piquer en son centre une étoile suspendue dans les airs. Spectacle, certes, croyance antique aussi: de l’aisance des cavaliers, de la précision de leur geste dépendra l’abondance des récoltes.
A Mamoiada, la fin du Carnaval est marquée par le défilé des «Mammuthones». C’est sans doute la fête la plus significative et la plus représentative de l’archaïsme populaire qui caractérise les régions de montagne, où vivent aujourd’hui encore les descendants de ceux que les Romains nommaient barbares, appellation qu’on retrouve dans la désignation de la région, «Barbagia».
Étrange accoutrement que celui des Mammuthones. Ces hommes rudes, bergers descendus des collines, portent sur le béret sarde un fichu de femme, bleu ou vert. Outre l’habit traditionnel de velours marron, ils endossent une peau de chèvre noire puis fixent sur leurs dos une dizaine de grosses cloches de vaches, pendent à leur cou quelques cloches plus petites. Et ce n’est pas tout: leur visage est recouvert d’un horrible masque sombre, de bois sculpté, la «vséra». Le mot «Mammuthones» lui-même vient du fond des âges. Il évoque à la fois un fantoche bacchique, un mystérieux bourdon sonore, les habitants de cavernes, des personnages de légende, des mythes et des idoles. Revêtir la tenue de «mammuthones», C’est donc, pour le berger des Mamoiada, endosser le passé secret de son peuple. Et, pour le spectateur, c’est reconnaître que la vie de ces lieux ne peut se résoudre aux clichés artificiels d’un folklore pour touristes. Les racines sardes plongent encore dans des temps de violence et de ténèbres et les coutumes de Carnaval sont la petite partie visible d’un édifice caché, ignoré des Sardes eux-mêmes, mais qui les lie au génie du lieu, au mystère de l’au-delà et à l’horreur des lointains frissons d’une terreur insurmontable.
Dans leur traversée de Mamoiada, les Mammuthones sont escortés – ou précédés – par quelques «Issohadores» (ou Issokadores), vêtus de lainages rouges et noirs, chapeautés de noir et tenant en mains de longues cordes de chanvre. A visage découvert, les Issohadores exécutent une espèce de procession dansée et solennelle, tandis que les Mammuthones, d’un pas plus pesant (n’oublions pas que leurs épaules portent le poids d’une quinzaine de lourdes cloches), marqué chaque fois du chant sourd des sonnailles, donnent l’impression de traîner à leurs pieds tous les péchés du monde.
A intervalles réguliers pourtant, leur pas lent se cabre, se dédouble en quelques pas rapides, qui font sonner cloches et sonnettes dans un rythme plus désordonné, inquiétant et gai à la fois. Grotesque et somptueuse, cette procession insensée marque le début de la belle saison. Acte d’expiation ou d’exorcisme? Acte de foi, en tout cas. En le passé. Et en l’avenir. Le proverbe affirme: «Pas de Mammuthones, pas de printemps».
Après les processions de la Semaine Sainte, qui dénotent plus un sentiment de piété qu’un goût de fête, le mois de mai est marqué par deux rendez-vous auxquels se rendent, en provenance de toute l’île, les amoureux de la tradition – et ils sont nombreux. Cagliari ouvre les feux, le 1er mai, avec la fête de San Efisio, officier de Dioclétien converti à la religion chrétienne et devenu le patron de la Sardaigne. Un immense défilé de cavaliers, de musiciens, de délégations de la plupart des villages de l’île, en costumes locaux, traverse la ville en portant la statue du saint, puis se rend à pied à Nora (cité située à près de trente kilomètres), d’où la statue ne sera ramenée, dans les mêmes conditions, que trois jours plus tard. Le retour de San Efisio marque la fin des festivités qui, bien que grandioses et strictement organisées, conservent un côté bonhomme, spontané et tendre.
Peu de temps après, les mêmes musiciens, les mêmes groupes folkloriques, les mêmes cavaliers se retrouvent à Sassari, pour la grande «Cavalcata sarda». Il faut avoir en tête la séculaire jalousie entre les deux principales villes de Sardaigne pour comprendre l’émulation qui pousse les organisateurs d’un lieu, puis de l’autre, à mettre sur pied une tête plus brillante que celle de l’année précédente et, surtout, plus fastueuse que celle de la cité concurrente. La réunion de Cagliari a pour elle d’être plus ancienne (elle a lieu, chaque année, depuis 1657), celle de Sassari présente l’avantage de se situer dans une région où le sens de la tradition a conservé plus de poids dans les communautés villageoises environnantes. Et que ceux qui n’auraient pu assister ni à rune, ni à l’autre, se rassurent: les fastes qui se déroulent en novembre à Nuoro, pour la fête de la Vierge des Grâces, permettront aux mêmes groupes, aux mêmes musiciens, aux mêmes…
Il ne faudrait pas, quel qu’en soit le chatoiement grandiose, se limiter aux fêtes des grandes villes. Car chaque village compte au moins deux fêtes annuelles, parfois plus (généralement, une fête votive dédiée au patron de chaque église). Et c’est là, sans doute, que vibre vraiment le coeur de la Sardaigne. Il suffit de vous y trouver à temps: l’extraordinaire hospitalité sarde fera qu’en quelques heures vous vous sentirez villageois à part entière! Et vous pourrez sans doute assister, succédant sur le podium rustique à un «ballo sardo» endiablé, à une de ces joutes de poètes dont l’usage remonte à l’antiquité.
Avec un peu de chance, les protagonistes se nommeront Zizi, Pazzola ou Masala. Vous verrez les vieux du voisinage se rassembler devant la scène en plein air, apportant à la main un tabouret ou une chaise de paille. Puis apparaîtront les poètes. Pas d’habit de lumière, non, un simple costume gris, presque aussi banal que la tenue d’un bureaucrate.
Ils s’installeront sur l’avant du podium, et attendront sagement que le public soit rassemblé et que, derrière eux, le chœur local ait pris place. Puis l’un des deux se lèvera et, en vers, improvisera selon l’humeur du moment, les événements de la semaine ou le caractère propre au village. Après quatre vers psalmodiés, le chœur marquera son approbation d’un refrain incompréhensible et triste, proche de ce que devait être la rumeur des fidèles après l’homélie des prêtres d’antan. Mais le poète, lui, parle de la vie d’aujourd’hui et son adversaire, après quelques minutes, lui oppose – en vers toujours – les arguments opposés.
On n’en est qu’au préambule et, peu à peu, se définit ce qu’il faut bien appeler l’ordre du jour des poètes. En accord avec leur propre sensibilité, les propositions du comité d’organisation et les réactions du public, ils proposent deux ou trois thèmes d’affrontement puis, si les spectateurs y souscrivent, poètes et choeur s’arrêtent quelques minutes.
Quelques retardataires en profitent pour glisser leur tabouret dans une rangée incomplète tandis que, verre de vin local à la main, chacun des poètes reprend son souffle et sollicite l’inspiration. L’un et l’autre seront bien nécessaires: dans quelques minutes, la joute reprendra et, sur des sujets aussi divers que les rapports entre générations, l’opposition de la terre et de la mer, le rôle de la femme dans la vie quotidienne ou la vie du travailleur émigré, les deux porte-poésie s’affronteront une bonne partie de la nuit, décrochant ici l’approbation du public, décochant là un vers, une tirade particulièrement venimeuse.
Extrême enchantement, indicible privilège que de pouvoir assister à telle joute de poètes, même pour le voyageur peu familiarisé avec la langue sarde. Prendre place parmi les vieux attentifs et critiques, se laisser bercer par le débit monocorde des poètes, vibrer avec une de leurs envolées, même sans en comprendre le sens, c’est pouvoir disposer d’un véritable outil de science-fiction: la machine à remonter le temps.