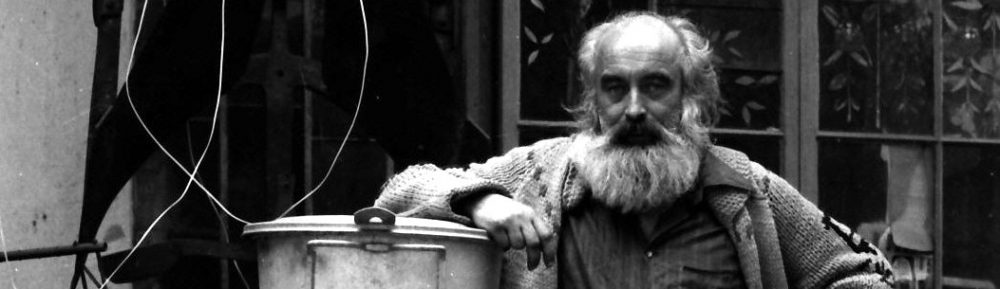Calgary. Un gros bourg de 700.000 habitants, au fin fond des plaines canadiennes, à l’abri des Montagnes Rocheuses. La richesse, désormais, c’est le pétrole. Les alentours en regorgent et les multinationales de l’or noir paieraient des fortunes pour installer un bureau entre Kensington Road et la Transcanadienne. Mais voilà… les maçons ne suffisent pas à l’ouvrage et les hommes d’affaires s’établissent à l’hôtel en conservant un oeil, attendri et impatient, sur l’armature de poutrelles métallique qui pousse hors du sol et constituera, un jour, leur siège social.
Jaloux, les Canadiens de l’Ouest nomment les Calgariens « White Arabs ». Et c’est vrai que, n’était le climat, on pourrait se croire, parmi derricks et trépans, à Abu Dhabi.
Les hommes de l’or noir ont la tenue de leurs collègues du monde entier, costume trois pièces gris pour les bureaucrates, salopette suiffeuse et casque jaune pour les travailleurs du terrain. Pourtant, au bas du pantalon des uns comme des autres, vous remarquerez la pointe et le talon biseauté, le reste de la botte est caché, comme en réserve.
Mais qu’approche juillet et la ceinture arbore aussitôt de gros dessins travaillés, le jean remplace la flanelle, la chemise à carreaux bouscule le veston, le foulard estompe la cravate. Et la banque de Nova Scotia installe un village indien dans son hall. Le Stampede approche. Les bottiers vont faire fortune.
Stampede. Ce mot signifie sauve-qui-peut. Mais, pour les cow-boys qui vivent dans la plaine, c’est d’abord le mouvement spontané, de tout un troupeau qui, sans raison apparente, sort de sa torpeur et fonce droit devant lui, écrasant tout sur son passage. Une sorte de débandade.
Le 1er avril 1912, un aventurier yankee descend du Canadian Pacific Railway. Calgary, c’est alors le bout du monde. Weadick, cavalier émérite et homme d’affaires avisé – croit-il – décide de mettre sur pieds, dans ce qui n’est encore qu’une bourgade de planches, des « Frontier Days » comme on n’en a jamais vus. Il y aura des chevaux, des girls, du spectacle.
Mais il dépense son dernier penny sans avoir convaincu quiconque. Il s’apprête à repartir lorsque quatre gros propriétaires le cautionnent. Le premier Stampede est né.
Aujourd’hui, c’est une ruée de centaines de milliers de personnes qui investit Calgary pendant dix jours, chaque été. Bureaux et silos sont désertés. Les carrefours redeviennent des places publiques où, dans le crin-crin d’un violon et d’un micro nasillard, toute la population se prend par le bras pour pratiquer une Square Dance bon enfant. Les chapeaux ressortent des armoires, prennent des dimensions de provocation permanente. Les Indiens, descendus des forêts du nord, installent leurs teepees au confluent de la Bow et de l’Elbow. Le tambour gronde.
Un casino fait tourner sa roulette dans les grandes halles de la foire aux bestiaux. Des voitures aux accessoires invraisemblables parcourent les rues de la ville. Le matin, sur tous les trottoirs, des chuckwagoons du temps de la conquête de l’ouest se transforment en cantines où sont offertes, à volonté, les crêpes épaisses qu’on fait ici, accompagnées de lard grillé, de saucisses grasses, de café tiède et de musique western égrenée par des cow-boys plus vrais que nature. Les cavaliers ont priorité sur les automobiles, les Indiens sur les policemen. C’est l’Amérique à l’envers.
Mais le vrai spectacle, celui qui attire fermiers, propriétaires, cowboys, commis de ferme, postiers du bout de la plaine, parieurs et cavaliers de tout poil, c’est le rodéo de l’après-midi.
Au pied de gradins monumentaux, dans une arène de poussière rousse cernée par des labyrinthes de tubulures, les concurrents se succèdent à un rythme effréné. Amateurs formant des équipes canadiennes, américaines, néo-zélandaises dans un premier temps. Professionnels du rodéo ensuite. Les disciplines sont multiples et diverses mais toutes ont un point commun: l’affrontement de l’homme et de l’animal, sommairement harnaché d’une selle ou d’une simple corde. Un nomme, jeans, protection de jambes, chemise impeccable, finit d’ajuster ses bottes. Il prend place, précautionneusement, sur le cheval fou, qui bave de rage et pète d’impatience et que retient encore un corral extrêmement exigu. L’homme est prêt, il lève le bras droit (ce bras qu’il ne devra plus, en aucun cas, ramener près de son corps ou de celui du cheval), un klaxon hurle, la porte de fer s’ouvre. Et c’est la bagarre.
Le cavalier va devoir tenir huit secondes sur sa monture déchaînée. C’est peu. Et c’est énorme. Il faut des reins d’acier pour n’être pas brisé par les ruades, les sauts, les bonds suicidaires.
Au coup de klaxon, l’homme est récupéré par un autre cavalier (à moins qu’il n’ait été désarçonné avant …) puis traverse l’arène à pied. Le public sait aussitôt, à sa démarche, s’il a gagné ou perdu, s’il souffre ou non.
Nouveau coup de klaxon. Cette fois, un taureau d’une tonne déchire la piste. L’homme n’a qu’a bien se tenir. Si le fauve le désarçonne, il tentera ensuite de le piétiner ou de l’encorner. Et rien n’indique que les clowns taurins, véritables acrobates et anges gardiens du spectacle, parviendront à détourner sa fureur.
Klaxon. Un veau traverse, tel l’éclair, la piste centrale. Un cavalier le poursuit au galop. Le lasso part, le cheval s’arrête net, la corde se tend, le veau se cabre, retombe à terre, le cow-boy est sur lui, lui lie les pattes et remonte en selle. Il s’est passé moins de dix secondes !
Tout-à-l’heure, ce sera le bouvillon saisi au vol et, ce soir, la course démente des chariots de l’Ouest. Sauve-qui-peut !
Dix jours d’affilée, il en sera ainsi. Pour chaque épreuve, une entreprise spécialisée mettra à disposition des organisateurs un cheval sauvage différent, qui ne devra pas avoir été approché par l’homme depuis plusieurs mois. Sous la ferraille des gradins, les cowboys se prépareront en silence, couvés par l’oeil envieux de gamins qui, un jour peut-être, entreront à leur tour dans l’arène survoltée.
Qui sont-ils, d’où viennent-ils, ces héros de quelques secondes ?
Ils ont roulé toute la nuit dans leur grosse guimbarde. Demain, ils seront déjà de retour dans leur ranch du Dakota, du Wyoming, du Saskatchewan ou de l’Alberta. La prairie n’attend pas, il faut conduire la moissonneuse, surveiller les troupeaux. Dans la famille, c’est le plus casse-cou qui, à la morte saison, s’est privé de vacances pour se payer une semaine ou deux à l’école de rodéo. Il en existe plusieurs dans chaque province canadienne, chaque état américain. Ecoles du risque, du courage. De l’inconscience aussi.
Ensuite, le rodeoman, tout en s’occupant des travaux de la ferme, s’est inscrit dans chaque fête de village. Les premières années, les gains des rares victoires ne couvraient p; même les frais de participation. Seuls, les meilleurs ont une petite chance de s’exhiber un jour au Stampede. Les autres, de guerre lasse, sont redevenus de simples cow-boys. A moins qu’un « bronco » particulièrement nerveux ne les ait condamnés aux béquilles ou à la chaise roulante…
Il n’y a guère de place pour les vieux, dans l’ouest américain. Pas plus pour les cow-boys que pour les businessmen. Une exception pourtant: à l’heure où tombe la nuit, dans la poussière du Stampede, un son strident donne le départ aux courses de « Chuckwagon ». Véritable poursuite de western. Quatre chariots de la conquête, quatre chevaux chacun, sans compter les cavaliers servants. Sur la maigre banquette de bois, les meilleurs « drivers » de l’Ouest. Huit guides en mains, ils foncent. Leur visage est crotté de boue et de sueur. Ils ont rarement moins de cinquante ans. La sagesse plus que la jeunesse.
Au pays du dollar, ce n’est pas chose fréquente. Et ce n’est pas le moindre mérite du Stampede.