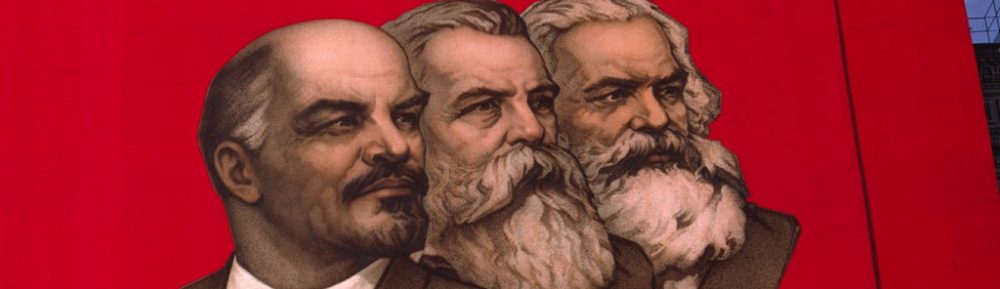A quoi donc cette différence pouvait-elle tenir? Dans nos jeux d’enfants, entre la grange et le bouquet de noisetiers, cachés entre les groseilliers et la palissade décatie qui délimitait tant bien que mal la surface du potager, nous passions nos étés à attaquer les diligences. Nous étions tantôt indiens et tantôt hors-la-loi et, face à nous, le shérif veillait.
Archives de l’auteur : alexadmin
Du plomb dans l’aile
L’avion, pour voyager vite et en sécurité. Tu parles, Charles! C’est vrai qu’on dort mieux dans un 747 que dans un bouge parisien, que le bruit y est moins intolérable et les couvertures moins mitées. Vrai aussi que le risque d’accident en fait le moyen de transport le plus sûr au monde, avant le patin à roulettes ou la marche à pied. Mais il y a avion et avion, et un certain nombre de coucous encore en service mériteraient une place de choix dans un catalogue de farces et attrapes…
D’Israël en Palestine
L’American Colony, à côté duquel trône un très beau minaret, se trouve tout juste après l’ancienne frontière qui, jusqu’à 1967, séparait la Jérusalem israélienne (ouest) de la Jérusalem jordanienne (est). La frontière n’est plus visible aujourd’hui, même si elle est clairement ressentie par chacun. L’hôtel est l’ancienne demeure d’un khalife qui y avait abrité ses quatre épouses, toutes aussi infertiles les unes que les autres, avant d’y mourir sans héritier.
Halloween
Un peu comme les Mexicains et pas du tout comme les Européens, les Américains fêtent la veille de la Toussaint dans la joie. Les devantures des magasins sont décorées de toiles d’araignées artificielles, de potirons enluminés ou entaillés en forme de visages, de squelettes de plastique gonflés, de têtes de mort. Demain, personne n’ira se recueillir dans les cimetières et, aujourd’hui, les enfants sont à la fête. A la nuit tombante, chacun se déguise, plus ou moins en rapport avec la mort, et passe de maison en maison, en quête de friandises que leur octroient les adultes. C’est aussi la seule fois dans l’année ou les enfants des familles noires pauvres de Bridgestone s’aventurent dans des quartiers blancs. Certains de ces jeunes noirs ont jusqu’à 18 ou 20 ans et obtiennent ainsi des babioles qu’ils ne pourraient se payer alors que les enfants blancs ne quêtent que jusque vers 12 ou 15 ans, pour le seul plaisir.
A midi, nous sommes allés nous promener au bord de l’océan, qui ressemble à un lac plutôt qu’à la mer, protégé qu’il est ici par la presqu’île qui nous cache l’immensité. Des joncs, quelques bateaux, quelques vols de canards et de hérons. Sur la terre ferme, des demeures coloniales, toutes plus luxueuses et brillantes les unes que les autres. Des Mercedes, des Porsche, quelques Peugeot. Guère de voitures américaines. On se veut cosmopolite. Pas de noirs non plus, on s’en serait douté. Puis nous sommes allés manger dans une espèce de blockhaus de luxe, le temps d’un sandwich copieux, pour nous, et de fromage fondu avec frites pour les enfants.
J’avais souhaité inviter tout le monde, le soir, au restaurant. Mais, du fait de Halloween et de la présence des enfants, Garry préfère que nous rentrions à la maison. En chemin, nous achetons donc dans un magasin de spécialités (Hay Day) du fromage bleu de Gex ( !), du crottin de Chavignol( !), des chanterelles, des champignons de Paris, de l’estragon, des cébettes. Et, en passant chez un traiteur italien, des pâtes qu’il ne restera qu’à faire chauffer. Sans doute cultivées plutôt que sauvages, les splendides chanterelles jaunes n’ont hélas strictement aucun goût et la vraie crème a la texture et le goût d’une béchamel industielle.
Pour le repas, Garry a sorti de sa réserve du Château de Mont 1990, mis en bouteille à Mont sur Rolle par François Naef, ainsi qu’un merlot Dehlinger 1985 du Sonoma County, en Californie. Le blanc est excellent et n’a pas souffert du voyage. Le rouge a été bon, mais tire déjà sur le madère, comme tous les vins aujourd’hui produits pour être aussitôt commercialisés et bus.
Un peu déçu par cette dernière étape new-yorkaise et son crochet par Bridgeport. J’ai cependant trouvé l’Amérique moins délabrée que je ne l’avais vue en mars. Peut-être parce qu’à l’approche des mauvais jours, les miséreux s’efforcent de trouver un logement plus habitable qu’un simple tas de cartons, ou parce que les élections ont poussé les politiques à cacher la misère, le temps du scrutin. Ou peut-être, tout de même, parce que l’Amérique commence à sortir de la crise. A moins que les pauvres, par sélection naturelle, aient commencé à disparaître… ici, rien n’est impossible.
Je n’aime décidément pas les villes
Près de quatre heures de vol entre Salt Lake et New-York, après un saut de puce d’une demi-heure entre Jackson Hole et Salt Lake. A New-York, taxi pris en commun avec une australienne blonde qui vient ici pour organiser la tournée d’un groupe folklorique d’aborigènes d’Australie. Bon vent.
A l’Algonquin, dormi presque tout de suite. Je commence à m’y sentir en pays de connaissance, après plusieurs passages en compagnie d’Amalric puis de Rodica. Les prix n’ont pas baissé, 170$ la nuit, soit environ 200 avec les diverses taxes.
Au matin, téléphone de Delia, manifestement fâchée que je ne sois pas venu dormir chez elle. Mais c’est si loin, si compliqué. Je la verrai plus tard, sans doute pour le repas de midi.
Il fait froid, un temps d’automne. Dans la 6è Avenue, deux Suisses, des Biennois, venus courir le marathon de New-York, ce dimanche. Sans intérêt. Longue attente au bar de l’hôtel jusqu’à l’arrivée d’Eliane. Petit visage de belette tendre, le cheveu châtain clair court, une extrême discrétion dans le vêtement. Toujours aussi chaleureuse, avec sa petite voix cassée et un rien chuintante. Elle accepte le principe d’une interview radio et nous voilà parlant de son voyage. C’était en 1963, l’année de la mort de Nehru. Elle avait 28 ans. Elle en a donc 57 aujourd’hui. Voyage au départ de New-York avec sa soeur Irène et une amie suisse-allemande. Japon, Corée, Thaïlande, Inde, Ceylan et Liban en un peu moins d’un an, chez l’habitant.
Pour le reste, revu New-York sans plus d’intérêt que les autres fois. A l’avenir, je m’efforcerai de n’y plus passer. Certes, il y a les musées, mais cette ville est d’abord celle de l’argent et de la déshumanisation. Difficile de s’y sentir bien, même si, parfois, on a çà et là l’impression de quartiers, de village. Parti par la Grand Central Station, tirant ma valise et portant mon barda dans cette foule pas vraiment agressive, mais où on ne croise pas le regard. Je n’aime décidément pas les villes.
Fairfield vs. Bridgeport
Parti de New-York Grand Central à 19h06. Une heure et quart dans un train de banlieue bondé, mais où chacun trouve tout de même une place assise. Garry A. m’a recommandé de descendre à Fairview, dernière station avant Bridgeport. Il m’attendra dans une VW Sirocco marron.
Nous finissons par nous trouver. Le gamin frondeur a blanchi sous le harnais. Il a toujours le cheveu frisé mais laisse pousser une barbe grise de trois ou quatre jours. Lunettes aussi. Les années, ma pauvre dame. Il est né en 1945 et a fait, je ne l’aurais jamais imaginé, le Vietnam comme marine. Il est historien de l’art et enseigne, d’une année sur l’autre, dans des universités différentes, faute de contrats fixes. Actuellement, il donne des cours, le mardi et le jeudi, dans le New-Jersey. En voiture, sans les encombrements, il en aurait pour une heure mais, en train et métro, via NY et avec cinq changements, cela lui prend trois heures et demie dans chaque sens. A noter que la voiture porte toujours, à l’avant, des plaques genevoises Z ainsi que, sur le pare-brise, une vignette autoroutière suisse de 1985.
La maison se trouve dans une petite rue de Bridgeport, mais très proche de Fairfield. Garry insiste sur ce point, Bridgeport étant réputée ouvrière et violente alors que Fairfield est calme et bourgeoise. La maison est assez ancienne, les voisins plutôt populaires, telle madame Roma, qui garde les deux enfants du couple pendant la journée. Après vingt ans d’Amérique, elle ne parle toujours que l’italien de sa campagne, passe la moitié de la journée à confectionner pour son mari des plats italiens issus, pour l’essentiel, du jardinet installé derrière la maison, tomates, poivrons, piments et autres légumes méditerranéens. Madame Roma en veut beaucoup à un de ses voisins, qui a menacé de s’adresser à la police si elle réalisait son projet annoncé d’élever des poules. Elle doit donc se rabattre sur des bestioles fraîchement tuées et pas même plumées, ce n’est guère l’habitude ici, que lui rapporte son mari, retraité d’un travail qui lui a laissé des blessures et une pension.
Quant à la maison de Gary et Jane, à qui il faut ajouter leurs deux faux jumeaux Mathiew et Francis, 2 ans et demi, elle est ancienne et abrite, au premier étage, une locataire divorcée. Construite en bois, elle compte au rez-de-chaussée un salon et deux chambres, ainsi qu’une cuisine. Le sous-sol a été transformé en bureau. C’est là que je loge, sur un canapé convertible. Dans le salon comme dans le bureau règne un solide désordre organisé, fait de livres et de papiers en tous genres, entassés sur chaque surface horizontale disponible. Gary prépare différentes publications, entre autres pour une encyclopédie, un article de 500 mots sur la culture et l’art suisses. Aucun auteur suisse n’a accepté, ce n’était pas assez bien payé. Gary projette aussi sur le même sujet un bouquin éventuellement financé par Pro Helvetia. Se demande s’il y intégrera une montre Swatch.
Gary me semble moins drôle que naguère. Malgré les apparences, il s’est embourgeoisé. Il a déjà voté (Bush) par correspondance la semaine dernière et espère que sa femme, toujours distraite selon lui, oubliera d’aller voter (Clinton) mardi.
Le rêve de Richard
Deux cafés noirs et en route, cap sud-est, vers le « ranch » de Richard. En fait, huit hectares de pré et de collines près de la Wind River, avec un étang, une source, deux écuries sommaires avec les plaques commémorant les victoires de sa jument Baby au concours de la Sarraz. Richard possède en tout 5 chevaux: 3 juments, un étalon et un poulain, mais voudrait, dans 5 ou 6 ans, revendre le motel pour se consacrer à l’élevage de quarter horses. Risqué. Me fait une démonstration de dressage avec et sans mors, de changement d’allures, de passage sur une planche à bascule, d’ouverture du portail de l »enclos sans poser pied à terre. Il ne pense manifestement qu’à ça. Grand enfant qui ne fait pas ses cinquante ans.
Au centre de Dubois, quatre ou cinq établissements, dont trois en particulier: le Outlow, où éclatent parfois d’homériques bagarres, le Rustic Pilles avec ses trois billards, son orchestre et son long bar où se retrouvent plutôt les cowboys d’un certain âge, et le le Ramshorn, juste à l’angle, où sévit un orchestre plus jeune et plus bruyant et où viennent les outfitters, en quêtes de filles qui ne semblent pas particulièrement pudibondes. Partout aux murs, des têtes de mouflons, de daims, de rennes, d’élans. Les femmes comme les hommes boivent la bière à la bouteille, Budweiser américaine ou Corona mexicaine.
Outre les bars, deux magasins de taxidermistes, où les chasseurs venus de loin apportent leurs victimes, comme aussi les pêcheurs leurs prises. Un général store, deux ou trois magasins où on achète le pain, la crème glacée et le café chaud. Et plusieurs motels. Celui de Richard, le Branding iron, est le second en prix et luxe, après le Stagecoach. Mais sans doute le plus beau. C’est aussi le seul, du moins en « ville « , à disposer d’un corral pour les chevaux des clients de passage.
Retour vers Jackson Hole. A noter, au milieu des troupeaux et particulièrement ceux de moutons, la présence de lamas, pour des raisons inconnues, ils font fuir les coyotes mieux que n’importe quel chien ou n’importe quelle winchester. Il y a maintenant des élevages de lamas rien que pour ça.
Dans l’immense plaine qui précède la ville, quelques centaines de cerfs sont déjà rassemblés pour affronter l’hiver et fuir les chasseurs. Il y en aura bientôt des milliers. La ville est très touristique. Le plus surprenant est la place carrée centrale. Jardin public enserré par une haie basse et ouvert, aux quatre coins, par une voûte de trois mètres de haut entièrement constituée par des bois de cerfs. Qu’on se rassure: les cerfs perdent leurs bois chaque année, pas la vie. La place est entourée de maisons dignes d’un western spaghetti, toutes en bois. Des magasins d’artisanat et de souvenirs, mais aussi deux bars. Le plus étonnant est le Million Dollars Bar, Toute l’architecture en est constituée par de grosses branches de ces pins qui, ici, se nouent de lourdes boules à intervalles plus ou moins réguliers, effet d’un parasite. Incrustées sur le plat du bar, 16 pièces d’un dollar en or, une devant chaque client. Pas de tabourets mais des selles mexicaines authentiques fabriquées, je crois à Sheridan. Hélas, la renommée du lieu, en attirant les touristes, a chassé les cowboys authentiques, qui ne s’y retrouvent que lors de rares rodéos.
Il va être temps de prendre congé de Richard et de son rêve western devenu réalité.
Dubois, prononcez Diouboïsse
Saut de puce entre Salt Lake et Jackson Hole, où j’étais venu dans les années 70 en provenance de Denver. Même impression de plonger dans un trou creusé entre les montagnes, nuageux et un peu inquiétant. L’aéroport ne comptait alors qu’une cabane de bois et, pour les bagages, un tapis roulant fait de simples rondins. Dans le hall, chemise à carreaux rouges, foulard, bottes western, ceinturon à boucle et large chapeau crème cachant en partie des yeux clairs et une barbe roussâtre, Richard S. Il pleuvine, la nuit tombe, nous franchissons les 80 miles qui nous séparent de Dubois. Nous parlons de la Suisse en crise et de de son propre chemin de petit fonctionnaire de l’État de Genève, de sa rencontre avec le cheval au travers d’un certain G. (est-ce un descendant de celui qui possédait des chevaux, juste après guerre, à Ferney, derrière le Capucin Gourmand, depuis lors enseveli sous le prolongement de la piste de Cointrin ?).
Richard abandonne son travail de fonctionnaire, dans l’incrédulité générale, pour devenir moniteur dans un centre équestre, au tiers de son salaire précédent. Depuis toujours, envie d’aller en Amérique. Premier voyage à Dubois. Le plus beau motel est à vendre, 23 chambres, tout en rondins., très agréable.
Le soir, Richard et sa femme Sara m’invitent au restaurant Rustic Pine Tavern où ils connaissent tout le monde. Sont manifestement bien considérés. Puis passons au bar de l’établissement, plus western tu meurs, billards au fond, long comptoir et petits alvéoles pour clients assis. Je suis le seul sans chapeau. Nombre des clients sont des outfits dont le métier consiste à emmener quelques poignées de touristes fanatiques en plein wilderness, Toute automobile est bannie et, sauf accident d’une gravité absolue, même un hélicoptère ne sera pas autorisé à vous venir en aide. Il y a aussi un négociant en bétail de la région de Cody, né à Bruxelles, ayant vécu au Vénézuela et au Chili, un peu fait mais passionnant; un autre qui se sait condamné par un cancer et continue à crâner. Il veut mourir à cheval. Le tout sans agressivité, avec bonhomie et humour.
Nuit un peu alcoolisée au bourbon et au Chablis californien. Aspirine.
Salt Lake
Arrivé un peu avant huit heures à Salt Lake en provenance de San Francisco. Deux contacts possibles ici: Marco Schlenz, le fils du coiffeur suisse d’Atlanta, qui est cuisinier; et Rick N., un Américain qui a vécu en France et qui, après une douzaines d’années passées aux USA à courir les foires dans lesquelles il promenait un tire-pipes, s’est installé à Salt Lake parce que sa soeur, mormone, y était venue avant lui. Il est devenu pianiste et tient à la radio une émission de musique classique, y compris contemporaine, qui lui vaut quelques inimitiés.
Marco, solide gaillard de 36 ans, arrive vers 21 heures, avec sa copine Julie, et nous allons boire de la bière en grignotant une pizza, dans une brasserie aux murs de brique, le Squatters. Marco m’a réservé une chambre dans l’hôtel historique de Salt Lake, le Peery. Il me croit sans doute riche: 80 dollars. Après avoir été le chef de cuisine qui a ouvert ici les plus grands hôtels, servant jusqu’à 800 couverts par jour, il vient d’ouvrir un petit restaurant western, le Bubba’s BBQ. Américain ou suisse, Marco? Difficile de le dire. Son schwytzerdütsch est émouvant, mais il vit à l’américaine, tenant aussi de sa mère américaine. Le personnage est ouvert, athlétique, et n’aime que trois choses: son boulot, l’argent et le ski, plus sa copine Julie, avec laquelle il se propose d’aller à Lugano en juin.
Au matin, tour de la cité mormone. On y étouffe beaucoup moins que voilà 15 ou 20 ans, lors de mon dernier passage. On y fume, on y boit de l’alcool, et les femmes soutiennent le regard. C’est que les mormons n’ont plus la majorité, malgré leur florissante progéniture.
Salt Lake est attrayante : impôts faibles, climat agréable (300 jours d’ensoleillement) et la montagne à deux pas, avec, bien sûr, « la meilleure neige du monde ». Du coup, pour ne plus payer de taxes ou vivre dans une ville moins polluée et moins embouteillée, les Californiens viennent en masse s’établir ici, au point que les prix, plutôt bas, grimpent vite.
Grimpé sur la colline pour prendre quelques vues. Tout est clean, pas grand intérêt. Passé rapidement au temple mormon puis revenu à l’hôtel où Julie devait passer me prendre. Puis allé dans le restaurant western de Marco, très loin du centre, une espèce de cambuse où on vient manger de la poitrine de porc fumée à la sauce aigre-douce, du poulet itou, des sandwiches. Marco affirme gagner, net, 20.000$ par mois. Il est à son aise derrière le bar, à servir des mets dont nous ne voudrions pas en Europe, et projette d’agrandir à côté, avec une salle distincte pour salades, quiches et tartes, mais avec cuisine unique.
Reconnu au premier coup d’oeil Jean B., le basque à moustache dont Marco m’avait parlé la veille. Accent du sud-ouest à couper au couteau, il est de Pau et importe en provenance de France et d’Espagne des chaussures pour enfants. S’apprête à se rendre en Argentine et surtout en Uruguay, où il a de lointains cousins que la famille française s’est évertuée à arracher à la dictature – y compris un ecclésiastique – en les faisant venir au pays Basque. Jean est venu ici à la suite d’un divorce américain. Il y semble à l’aise, court le guilledou et adore le sport. Mais sa passion, c’est de collectionner des centaines de bouquins portant sur le pays basque et les Pyrénées.
Underground à Atlanta
Quitté Mexico vers 10 heures mais, avec le décalage et, surtout, l’invraisemblable attente pour le contrôle d’identité, il est près de 17 heures lorsque je prends le volant de la Chevrolet Corsica louée pour 60$ par jour. Approche d’Atlanta par le sud, artères démesurées et sky-line de toute ville américaine rapidement grandie. Il y avait 700.000 habitants dans les années soixante. Il y en a 2,5 millions aujourd’hui. Première vision, celle du stade couvert de 45.000 places où l’avant-dernière rencontre entre les Blues Jays de Toronto et les Braves d’Atlanta doit avoir lieu ce soir. Puis la ville et l’interminable Peachtree Street. Sans doute quinze kilomètres de longueur, avec aux deux bouts des groupes de gratte-ciel et, au centre, une zone plus ancienne ou, du moins, plus humaine. Je tourne en rond à la recherche d’un motel. Ressors vers le sud. En dehors des grands axes, quartiers misérables, noirs bien sûr. Retour au centre pour trouver finalement un Travel Lodge bien central, à deux pas d’un Impérial Hôtel en ruines, promis à la démolition et qui sera sans doute bientôt remplacé par un nouveau gratte-ciel.
Le temps de poser les bagages, coups de fil à Kurt Schlenz, répond à son salon de coiffure et qui m’explique comment le rejoindre. Son salon de coiffure se trouve dans Midtown, vers le nord, à mi-chemin de Buckhead. J’y suis en moins d’une demi-heure et, entre deux clientes, dans son salon petit, au pied d’un immeuble abritant 1200 personnes, essentiellement des fonctionnaires noirs. L’homme a 62 ans, il est originaire de Schaffhouse et a choisi de venir vivre ici en 1953, à la lecture d’une petite annonce dans le journal des coiffeurs. Il travaillait alors à Montreux, ce qui explique sa bonne maîtrise du français, dans lequel les américanismes sont plus fréquents que les germanismes. Il y a une centaine de Suisses à Atlanta. L’un d’eux, Hans B., fut le premier. Envoyé ici par une société suisse qui y avait acheté des terres, il a d’abord exploité une ferme de vaches laitières et continue aujourd’hui d’élever du bétail de boucherie.
Le soir, sur recommandation de Kurt, je vais à l’Underground, un espace de loisirs et d’animation créé en sous-sol, presque au centre. Une rue couverte, vieilles maisons formant mail, nombreux magasins, échoppes, bistrots. Partout, la foule est pendue au poste de TV pour suivre le match de baseball qui oppose à Toronto les Blue Jays aux Braves d’Atlanta. Le gagnant final sera le premier vainqueur de quatre manches successives. Atlanta a perdu les trois premières, puis en a gagné une et, ce soir, va remporter la seconde. Hystérie collective. J’entre au Hooter. Ecrans partout. Pas une conversation mais des silences d’émotion suivis de cris de joie.
Les hôtesses, spécialité du Hooter, sont splendides. Noires pour la plupart, elles doivent avoir entre 16 et 20 ans, sont chaussées de baskets et vêtues d’un joli short orange moulant leur petit cul émouvant de candeur et de rondeurs, sans oublier le t-shirt noué dans le dos pour découvrir de belles cambrures sportives. Celle qui m’accueille fait, paraît-il, de la danse. Elles prennent les commandes et servent, mais elles ont aussi mission, en tout bien tout honneur, d’engager la conversation avec les clients, hommes ou femmes. Elles le font en riant, s’intéressant aux propos des clients et riant avec eux. Tout ça est bien sûr du commerce mais je serais prêt à parier qu’elles y prennent plaisir.
Plus prosaïquement, je me rabats sur un grand plat composé de pattes d’araignées de mer, de crevettes, de salade de fruits de mer et d’un joli tas d’ailes de poulet, enrobées de panure et trempées dans la friture. Pas vraiment mauvais mais un rien gras.