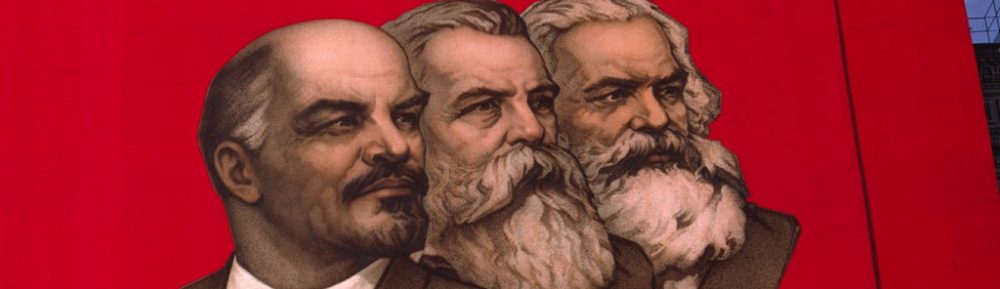Le jour s’est levé sur Long Beach, mais pas encore le soleil. Dans le jardin, le gazon tend vers la grisaille d’hiver mais les hibiscus et les bougainvillées conservent leurs fleurs jaunes, mauves, violettes. Il fait chaud, environ 20 degrés, et humide. La maison est parfaitement tenue. Epaisse moquette partout, deux salles de bains dont une que Camtu me recommande d’éviter au profit de la sienne. Un set de linges de toilette et des crèmes pour le corps m’y attendent.
Difficile d’imaginer quelque ambiguïté entre nous. Peut-être suffirait-il que je déporte de quelques centimètres mes baisers de grand frère, que je serre différemment la main que Camtu pose, depuis le début, sur mon genou. Mais je ne le ferai pas. D’abord à cause de Rodica. Ensuite parce qu’il me semble plus passionnant de développer ce rôle de confesseur. A l’amant, elle ne montrerait qu’une facette. A l’ami elle se dévoilera et ma curiosité est plus grande que mon désir. D’ailleurs, Camtu n’est plus aussi belle sous certaines lumières, à certains propos. De face, son visage reste angélique bien que plus rond mais, de profil, elle tient parfois du boxeur décidé et têtu. Il ne fait sans doute pas bon l’avoir pour ennemie.
Paroles. Camtu vide son sac comme elle ne l’a sans doute jamais fait. Quinze années de silence ont fait de moi un confesseur. Haïti tout d’abord. Elle m’avait dit alors qu’elle était vietnamienne, venait de passer quelques jours en Jamaïque et enseignait en Californie. A Cap Haïtien, elle m’avait présenté l’homme d’un certain âge, allemand, qui l’accompagnait, comme une personne rencontrée la veille dans l’avion Je n’y avais pas cru et, lorsqu’elle m’avait demandé comment obtenir un passeport suisse afin de pouvoir faire le tour du monde, j’avais vu en elle une quelconque agente secrète de je ne sais quel service. Or, tout ce qu’elle me disait était vrai.
A l’université de Los Angeles, elle était alors spécialisée dans l’évaluation et la mise au point de méthodes de linguistique. Elle gagnait bien sa vie mais avait appris qu’il lui était possible de faire un extra, dans sa spécialité, en Floride, pour une ou deux semaines. Elle s’y était rendue et, avec l’argent supplémentaire ainsi gagné, s’était rendue en Jamaïque et en Haïti pour quelques jours de dépaysement. Elle ne disposait alors que d’un document de voyage délivré par les USA, ce qui rendait difficile tout déplacement, alors qu’elle rêvait de courir le monde et n’obtiendrait sa nationalité américaine, au mieux, que quatre ou cinq ans plus tard.
Camtu avait appris par un Suisse de Los Angeles que le mariage avec un Hélvète conférait la nationalité immédiate. Elle m’avait donc demandé de l’aider, tour était clair. D’où le mariage à Meyrin avec Norbert Pasche, ami de Jean-Jérôme, qui disait faire ça pour la gloire mais s’était vite amouraché de « sa » femme au point qu’elle avait dû quiter la Suisse deux ou trois jours plus tard, passeport en poche. Depuis lors, elle avait divorcé en 1980, malgré son mari qui, par avocat interposé, lui faisait savoir qu’il l’aimait encore, lui qui ne l’avait vue qu’une ou deux fois, le temps du mariage, et qui ne l’avait jamais embrassée ni même approchée…
Est-ce avant ou après son tour du monde, elle avait rencontré quelque part un Allemand prénommé Thomas et, cette fois, c’est elle qui était tombée amoureuse. Il était architecte, vivait dans un petit village du Taunus et elle était allée vivre avec lui dans le froid, juste vêtue d’un pull péruvien – c’était donc après le tour du monde – et de son Olympus M2. « Hausfrau » elle avait été, vivant seule le jour durant, juste égayée pas la visite du gosse des voisins, Matthias, qui avait commencé à lui apprendre l’allemand. Deux mois plus tard, elle échangeait sa méthode de linguistique, enseignée au profs de Frankfort, contre des cours d’allemand intensif et, à la fin de son séjour, publiait chez un éditeur allemand une méthode révolutionnaire de grammaire anglaise (une série de cercles de carton, lisibles à la manière des disques de stationnement…) qui lui rapporte aujourd’hui encore quelques royalties.
Mais revenons à son voyage de routarde. La voilà en Amérique centrale, puis en Colombie. Puis en Equateur d’où elle se rend aux Galapagos en avion militaire et participe au baguage des tortues géantes par un couple de biologistes animaliers. Puis la Haute-Amazonie, puis le Rio Grande do Soul, d’où elle embarque sur un cargo à destination de l’Afrique du Sud, qu’elle contourne ensuite pour se retrouver en Israël où elle est, dans la rue, contactée par un grand metteur en scène de théâtre, en quête d’une comédienne asiatique pour une pièce que les autres répètent déjà. Elle apprend son texte par coeur, sans comprendre l’hébreu, puis se fait envoyer des USA la pièce en anglais, pour savoir au moins de qui il retourne. Elle reçoit de l’argent, un appartement, une maison, prend des cours d’hébreu en immersion et s’exprime aujourd’hui encore dans cette langue, comme d’ailleurs en allemand, que j’ai pu tester. Puis, lorsque la frontière s’ouvre entre Israël et l’Egypte, elle est dans le premier bus des officiels et journalistes qui, après une ultime journée d’attente au poste frontière égyptien, pénètrent dans ce territoire autrefois ennemi. Entre-temps, elle a lié amour avec un officier de renseignement israélien qui voudrait l’épouser mais y renonce. Il veut que ses enfants soient juifs et c’est impossible avec une mère asiatique. Puis encore l’Asie du Sud-Est, l’Inde, Bali, le Japon je crois, à l’exception bien sûr du Vietnam qu’elle a quitté en 1967.
Ce tour du monde, c’est une découverte, mais c’est surtout une fuite. Elle a quitté le carcan familial à 20 ans, poussée dans un avion par son père, procureur de la république, qui l’avait inscrite à l’université de Liège. A cet âge, elle n’avait pratiquement jamais touché un billet de banque. De la maison familiale située sur la route de Than Son Nhut, ou de l’immense propriété du delta, appartenant à la famille de sa mère, elle ne sortait en ville qu’en voiture avec chauffeur, ne s’occupait jamais de payer, ne savait rien de la vie. Ou à peu près rien.
Une fois pourtant – elle avait dix-sept ans – elle avait fait discrètement le mur du couvent des Oiseaux où elle était élève, pour rejoindre au pavillon « peste » de l’institut Pasteur tout proche un officier américain qui l’avait calmement, définitivement, dépucelée sur un sac de couchage militaire jeté sur le sol carrelé du laboratoire d’analyses, parmi les éprouvettes. Elle y était allée sans désir, sans amour, en toute connaissance de cause, simplement parce qu’elle savait qu’un jour ce moment arriverait et qu’elle voulait que ce soit avec un homme d’un certain âge, maître de ses pulsions et connaissant les choses de la vie.
L’homme l’avait connue quelques jours plus tôt alors qu’elle conduisait le scooter enfin offert par ses parents. De sa jeep, l’officier avait demandé à son chauffeur de s’enquérir auprès de cette fille en mini-jupe, cheveux au vent, de son numéro de téléphone, comme il l’aurait fait avec une pute. Elle s’était affolée, était tombée, s’était blessé un genou. L’officier l’avait ramenée chez ses parents. Il était médecin et avait confectionné un pansement, puis était revenu les jours suivants pour le renouveler. Puis il y avait eu le pavillon de la peste. Si son père l’avait appris, il l’aurait tuée. Elle a revu l’homme, vingt ans plus tard, en Californie.
L’histoire du père, francophone, francophile, fin lettré et magistrat, est un roman à lui tout seul. Mariage de convenance à vingt ans avec une jeune fille riche, choisie par ses parents, qui attendaient que le gendre reprît les immenses exploitations de canne du delta. Ils lui reprochèrent toujours d’avoir préféré le droit et la justice. Etait née une première fille, puis deux fils. Le père était parti pour Paris afin de terminer sa formation universitaire. Sa femme, qui ne parlait pas un mot de français, ne l’avait pas suivi. A Paris, il avait découvert la vie facile, les femmes, et commencé à se désintéresser de ses études. Il vivait avec une française de petite vertu, qui venait de lui donner une fille, Lydie, aussitôt remise à l’assistance publique.
Avait alors surgi, à Paris, sa femme vietnamienne, parvenue jusque-là sans toujours parler un mot de français. Elle avait récupéré son mari, vivant avec lui dans des conditions précaires, l’obligeant à reprendre et terminer ses études, puis l’emmenant à Saïgon. Toute sa vie, la mère n’a cessé de faire payer au père son incartade de jeunesse. Toute sa vie, elle a distillé le fiel, l’amertume, à l’égard de ses enfants comme de son mari. Et toute sa vie l’homme a supporté, stoïque, se réfugiant dans l’écriture de romans en vietnamien et de poèmes en français ainsi que d’une histoire du théâtre traditionnel vietnamien qui fait, aujourd’hui encore, autorité.
A la mort de son père, Camtu s’est convertie au bouddhisme, elle qui apprenait le catéchisme au couvent des Oiseaux. Dans sa maison californienne, un autel est élevé à son père, pour lequel elle allume chaque soir un bâton d’encens tandis qu’un projecteur éclaire un petit Bouddha d’albâtre.
Un mot encore de ses deux frères, Gilles et Guy. Ils portent un nom français parce que, dans les années soixante, le père les avait poussés sur un bateau clandestin. A leur arrivée à Hong-Kong, ils avaient déclaré être les enfants d’un couple français. L’un et l’autre sont restés en France, complètement francisés. Guy est haut fonctionnaire au ministère de l’Agriculture. Leurs parents les ont rejoints à la chute de Saïgon, en 1975.